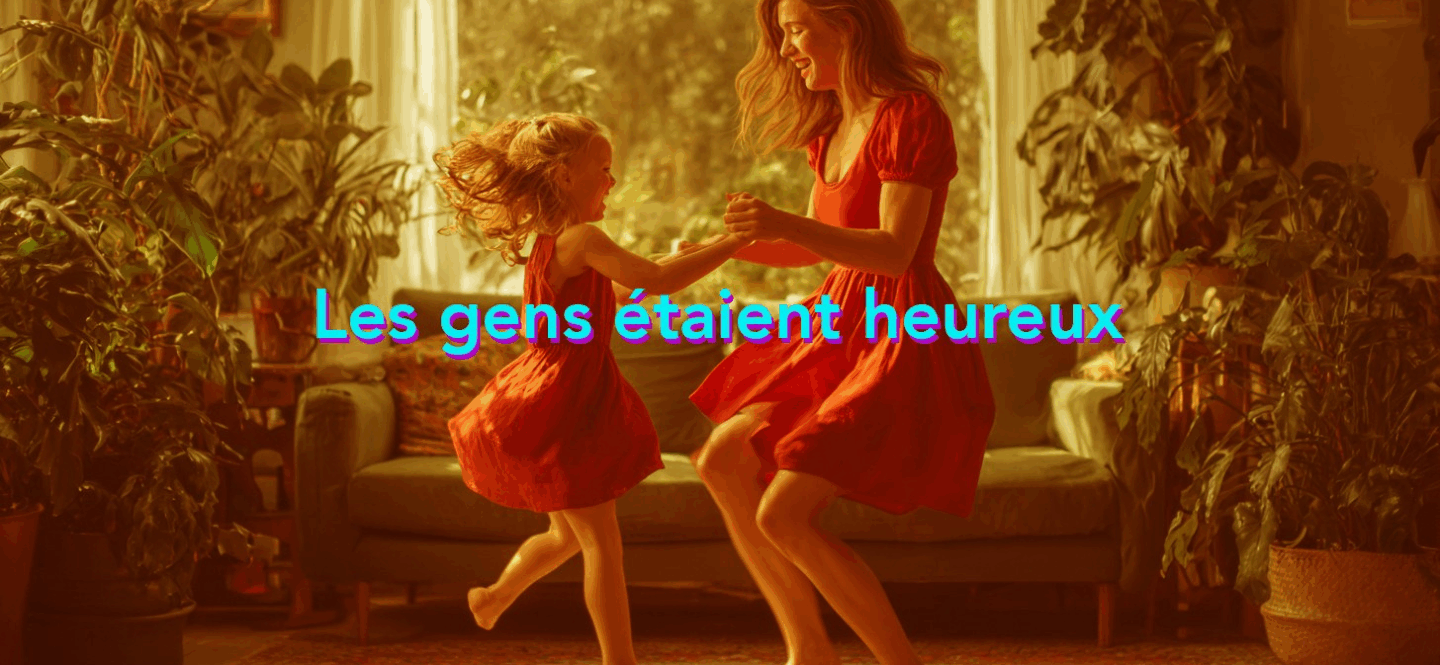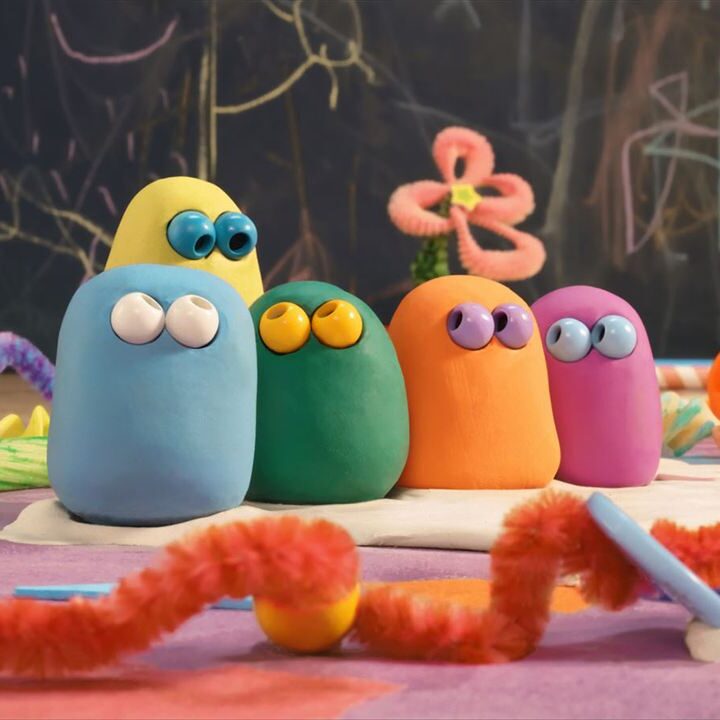Dans l’imaginaire commun, la science-fiction est souvent associée à une série de motifs devenus stéréotypes du genre : voyages intergalactiques, conquêtes spatiales, héros solitaires, machines intelligentes prêtes à se rebeller.
Ces récits, portés par la figure récurrente d’un héros masculin, blanc, rationnel et conquérant, participent d’un imaginaire technologique fondé sur la domination de la nature, des machines, des autres planètes, voire des autres peuples.
Les technologies contemporaines entretiennent un dialogue étroit avec l’esthétique du cinéma hollywoodien, dont elles s’inspirent et qu’elles inspirent en retour. À travers ces images de puissance et de conquête se rejouent les fictions du capitalisme, auxquelles les sciences elles-mêmes, soumises à ses logiques, participent parfois à leur insu : culte de l’innovation, promesse de transparence, fascination pour la maîtrise et la conquête de l’inconnu.
Or ces récits sont aujourd’hui inopérants face à l’état du monde, traversé par des crises écologiques, politiques et technologiques d’une ampleur inédite.
Depuis les années 1960 déjà, une autre science-fiction propose des contre-récits : elle conteste l’idée d’une science (ou d’une science-fiction) neutre et universelle, ainsi que la croyance dans la toute-puissance technologique. Nourrie par des pensées féministes, décoloniales et écologiques, elle redonne à la fiction un rôle critique et spéculatif.
Ces récits imaginent d’autres futurs, attentifs aux relations de pouvoir, aux écosystèmes, aux pratiques de soin et aux savoirs situés, révèlant ce que les imaginaires technoscientifiques dominants tendent à invisibiliser.
Animés par une même intention, artistes, chercheur·es et théoricien·nes auscultent aujourd’hui les systèmes techniques, économiques et symboliques contemporains.
Par des pratiques d’enquête, de détournement ou de spéculation critique, ils et elles déjouent les logiques d’appropriation qui lient science, économie et imaginaire, produisent des contre-fictions, observent comment le capital s’incarne dans les formes mêmes de la représentation et tentent d’en dérégler les mécanismes.
Penser depuis l’ombre, c’est accueillir l’inconnu comme espace de résistance et de création, et déplacer le regard hors du champ éclairé de la technoscience, vers ses marges : là où se trament d’autres manières de connaître, de raconter et de vivre ensemble.